 L’étude suivante « Les Reptiles et Synapsides fossiles de Bourgogne » vient d’être publiée dans le Hors-Série n°12-2012 de la Revue Scientifique Bourgogne-Nature intitulé ATLAS DES REPTILES DE BOURGOGNE. Cet ouvrage, coordonné par Daniel SIRUGUE et Nicolas VARANGUIN, se veut être une référence pour améliorer ses connaissances sur les Reptiles de Bourgogne. Notre étude sur les fossiles constitue un chapitre de cet Atlas. Ce chapitre vient compléter l’inventaire publié en 2013 sur les Amphibiens fossiles de Bourgogne. De la même manière que le chapitre sur les amphibiens, il fait donc suite à deux stages universitaires de L3, réalisés en 2004, respectivement sur la « Faune et la Flore du Morvan, du Dévonien au Jurassique » (B. Brigaud) et sur l’«Inventaire, Histoire et Evolution des Reptiles et des Amphibiens fossiles en Bourgogne » (R. Bourillot). Ces deux études, comprenant deux rapports détaillés, ont servi de données de base à Georges Gand, qui les a largement complétées et adaptés à partir de ses données personnelles, de recherches bibliographiques et de plusieurs visites au Muséum d’Histoire naturelle Jacques de La Comble d’Autun. Le texte actuel correspond à un inventaire concernant les Amniotes (Synapsida et Reptiles) fossiles réalisé à partir des collections bourguignonnes. Les fossiles sont présentés dans ce chapitre dans l’ordre stratigraphique. Il montre que les Synapsida (Reptiles Mammaliens) sont représentés au Carbonifère et au Permien inférieur par quelques squelettes. Dans le reste du Permien (moyen ou moyen à supérieur) ) puis au Trias, c’est la palichnofaune qui prend le relai avec quelques empreintes de pas permiennes attribuées à des Capthorinomorpha et avec celles beaucoup plus nombreuses du Trias laissées par une faune très variée. Celle-ci comportait le groupe souche des Crurotarsi d’où sont issus les Crocodylomorpha et les Dinosauria via les Dinosauriformes qui ont laissé des petites traces de pied tridactyles, fréquentes dans le Trias moyen. A partir du Trias supérieur (Rhétien), apparaissent des restes osseux d’Ichthyosaures et de Plésiosaures qui vont être rencontrés jusqu’à la base du Crétacé supérieur. Ces Reptiles marins carnivores ont donc évolué pendant près de 100 millions d’années dans la mer bourguignonne en compagnie de Crocodiliens dont on perd la trace à la fi n du Jurassique dans notre région. La mer du Crétacé supérieur dite de la craie est riche en restes osseux de Mosasaures, grands lézards prédateurs qui semblent avoir pris le relai des Ichthyosaures et des Plésiosaures qui n’ont pas été trouvés dans le reste du Crétacé supérieur bourguignon. Quelques Dinosaures herbivores ont été recueillis dans l’Yonne. Les données paléogéographiques de cette période suggèrent la possibilité d’en trouver d’autres dans ce département. Tous les groupes de Reptiles évoqués précédemment disparaissent au cours du Crétacé supérieur et, peut-être, de manière brutale pour les Dinosaures à la limite du Crétacé et du Tertiaire (crise K-T).
L’étude suivante « Les Reptiles et Synapsides fossiles de Bourgogne » vient d’être publiée dans le Hors-Série n°12-2012 de la Revue Scientifique Bourgogne-Nature intitulé ATLAS DES REPTILES DE BOURGOGNE. Cet ouvrage, coordonné par Daniel SIRUGUE et Nicolas VARANGUIN, se veut être une référence pour améliorer ses connaissances sur les Reptiles de Bourgogne. Notre étude sur les fossiles constitue un chapitre de cet Atlas. Ce chapitre vient compléter l’inventaire publié en 2013 sur les Amphibiens fossiles de Bourgogne. De la même manière que le chapitre sur les amphibiens, il fait donc suite à deux stages universitaires de L3, réalisés en 2004, respectivement sur la « Faune et la Flore du Morvan, du Dévonien au Jurassique » (B. Brigaud) et sur l’«Inventaire, Histoire et Evolution des Reptiles et des Amphibiens fossiles en Bourgogne » (R. Bourillot). Ces deux études, comprenant deux rapports détaillés, ont servi de données de base à Georges Gand, qui les a largement complétées et adaptés à partir de ses données personnelles, de recherches bibliographiques et de plusieurs visites au Muséum d’Histoire naturelle Jacques de La Comble d’Autun. Le texte actuel correspond à un inventaire concernant les Amniotes (Synapsida et Reptiles) fossiles réalisé à partir des collections bourguignonnes. Les fossiles sont présentés dans ce chapitre dans l’ordre stratigraphique. Il montre que les Synapsida (Reptiles Mammaliens) sont représentés au Carbonifère et au Permien inférieur par quelques squelettes. Dans le reste du Permien (moyen ou moyen à supérieur) ) puis au Trias, c’est la palichnofaune qui prend le relai avec quelques empreintes de pas permiennes attribuées à des Capthorinomorpha et avec celles beaucoup plus nombreuses du Trias laissées par une faune très variée. Celle-ci comportait le groupe souche des Crurotarsi d’où sont issus les Crocodylomorpha et les Dinosauria via les Dinosauriformes qui ont laissé des petites traces de pied tridactyles, fréquentes dans le Trias moyen. A partir du Trias supérieur (Rhétien), apparaissent des restes osseux d’Ichthyosaures et de Plésiosaures qui vont être rencontrés jusqu’à la base du Crétacé supérieur. Ces Reptiles marins carnivores ont donc évolué pendant près de 100 millions d’années dans la mer bourguignonne en compagnie de Crocodiliens dont on perd la trace à la fi n du Jurassique dans notre région. La mer du Crétacé supérieur dite de la craie est riche en restes osseux de Mosasaures, grands lézards prédateurs qui semblent avoir pris le relai des Ichthyosaures et des Plésiosaures qui n’ont pas été trouvés dans le reste du Crétacé supérieur bourguignon. Quelques Dinosaures herbivores ont été recueillis dans l’Yonne. Les données paléogéographiques de cette période suggèrent la possibilité d’en trouver d’autres dans ce département. Tous les groupes de Reptiles évoqués précédemment disparaissent au cours du Crétacé supérieur et, peut-être, de manière brutale pour les Dinosaures à la limite du Crétacé et du Tertiaire (crise K-T).
Mais les Reptiles n’ont pas tous disparu car nombreuses sont les familles de Chelonia, Crocodilia, Lacertilia, , Ophidia qui vont survivre à cette crise et continuer leur évolution pendant le Tertiaire. Par suite de modifi cations paléogéographiques et climatiques, en France et en Bourgogne en particulier, hormis celles de Crocodilia, les autres vont devenir résiduelles. L’herpétofaune moderne est globalement mise en place, il y a une centaine de millénaires (Pléistocène). En Bourgogne, il y a actuellement 5 espèces de couleuvres, 1 de vipère (peut-être 2), 5 de lézards et 1 de tortue dont le suivi est assuré par des spécialistes. Face à certaines activités humaines destructrices, quelques unes de ces espèces sont menacées mais depuis une dizaine d’années plusieurs associations et organismes publiques bourguignons, français et européens ont uni leurs efforts pour que cette herpétofaune soit protégée.Amphibiens de type moderne ou Lissamphibiens puis de leurs ancêtres les Stégocéphales bien représentés dans notre région dans les terrains du Carbonifère supérieur et de l’Autunien (Permien inférieur).
Le 4 juillet, la réunion thématique de l’Association des Sédimentologistes Français organisée par le laboratoire Géosciences Paris-Sud (GEOPS) sur le thème de la « Diagenèse : avancées récentes et perspectives » a réuni 110 personnes à Orsay. Cette réunion a été organisée en l’honneur de Maurice Pagel (Professeur émérite à l’Université Paris-Sud) qui s’est attaché une grande partie de sa carrière à comprendre les processus diagénétiques « i.e. transformations physiques, chimiques ou biologiques qui se produisent dans les sédiments, débutant immédiatement après leur dépôt pour se prolonger jusqu’à aujourd’hui » dans les bassins sédimentaires.
L’objectif a été de rassembler des spécialistes couvrant un domaine allant des approches académiques aux applications industrielles afin de faire le point sur notre compréhension des processus diagénétiques dans les séries sédimentaires carbonatées, silicoclastiques ou argileuses et leur intégration dans la prédiction des qualités des réservoirs pétroliers, de stockage (de déchets radioactifs par exemple) ou d’accumulation d’hydrocarbures et de métaux stratégiques.
L’intérêt majeur a été de réunir des chercheurs du monde universitaire et des ingénieurs du monde industriel issus soit d’établissements publics à caractère industriel et commercial comme le Brgm, l’Andra, l’IFPEN ou des grands groupes de l’énergie comme Total ou Gdf-Suez. La vingtaine de présentations, dont deux réalisées par des chercheurs invités de l’University of Liverpool et de la KU Leuven, a permis de faire un état des lieux sur les avancées nouvelles du domaine notamment concernant les méthodes de reconstruction de l’histoire thermique des bassins sédimentaires, de datation des minéraux authigènes ou de modélisation mettant en lien la qualité des réservoirs pétroliers avec la diagenèse. La réunion aura permis de discuter les perspectives nouvelles et d’identifier les défis à relever dans le domaine de la diagenèse afin de faire émerger des collaborations.





















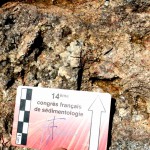


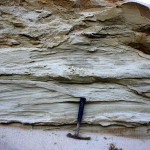
 orcid.org/0000-0001-6961-2177
orcid.org/0000-0001-6961-2177