Dans les réservoirs géologiques silicoclastiques -estuariens notamment- la présence de tapissages argileux souvent en chlorite (clay coatings en anglais) autour des grains de quartz limitent grandement le développement des surcroissances de quartz. Les tapissages argileux permettent ainsi la préservation de bonnes propriétés réservoirs à de très grandes profondeurs (>4000 m), là où normalement les sédiments sont complètement cimentés. Dans ces formations détritiques, même si le lien entre présence de tapissages argileux et préservation de bonne porosité-perméabilité est maintenant bien admis, il existe beaucoup d’incertitudes sur l’origine du dépôt ou de la formation d’argiles dans les grès. Normalement, au moment du dépôt, le tri des grains engendré par l’hydrodynamisme empêche les argiles de se déposer en même temps et au même endroit que les sables. Pourtant, certains sédiments sableux contiennent des argiles en quantité non négligeable dans le registre fossile ou moderne. Il s’avère que les conditions de dépôt des argiles (<4 µm) avec du sable grossier au moment de la sédimentation dans un environnement à fort hydrodynamisme est un paradoxe sédimentologique qu’il convient de mieux appréhender. Afin de mieux comprendre les processus à l’origine du dépôt simultané d’argiles et de sables, et d’améliorer la prédiction de la distribution spatiale des roches réservoirs en sub-surface (notamment celles formées dans des estuaires fossiles), il a été envisagé d’étudier les sédiments déposés actuellement dans un estuaire hyper-turbide : l’estuaire de la Gironde (Sud-Ouest, France).

Dans le cadre du projet Claycoat, collaboration scientifique entre l’Université Paris Sud, l’École Nationale Supérieure en Environnement, Géoressources et Ingénierie du Développement durable (ENSEGID) de Bordeaux, l’Université de Poitiers et Engie, 10 campagnes de carottage sur des barres sableuses remplissant l’estuaire de la Gironde ont été réalisées entre novembre 2015 et mai 2017. Ces campagnes de carottage, pilotées par Maxime Virolle (Univ. Paris-Sud) ont permis de réaliser 10 carottes sédimentaires pour un total de 50 m carottés dans 3 barres sableuses positionnées dans l’estuaire entre Bordeaux et le phare de Richard (barres de Bordeaux, de Plassac et de Richard). La description des carottes permet de reconstituer l’histoire de formation de ces barres sableuses remplissant actuellement l’estuaire de la Gironde depuis 6 000 ans, bien calée par les datations réalisées au carbone 14 et au Cs/Pb sur les matières organiques et sédiments récoltés sur les carottes. L’observation au microscope des échantillons a permis de mettre en évidence la présence quasi systématique d’argile (essentiellement smectite et illite) dans les sables, formant des agrégats de plusieurs dizaines de micromètres collés sur la surface des grains de quartz. Au sein des agrégats argileux, d’autres éléments sont identifiables tels que la pyrite, des éléments carbonatés ou des diatomées. Les diatomées sont observées tout le long de l’estuaire dans les échantillons, et les biofilms qu’elles produisent pourraient jouer un rôle important dans le collage des particules argileuses à la surface de grains détritiques, participant ainsi au piégeage des argiles dans les sables de l’estuaire de la Gironde. Ces argiles qui tapissent en partie les grains détritiques constitueraient un précurseur important à la formation de coatings bien cristallisés si, lors de l’enfouissement, elles se transforment en minéraux argileux bien cristallisés (chlorite et/ou illite) recouvrant la totalité des grains de quartz et préservant la porosité et la perméabilité à de grandes profondeurs.
L’origine et la distribution spatiale de ces argiles dans les sédiments sableux sont donc des enjeux majeurs dans la prospection de réservoirs pour le stockage de gaz ou la géothermie haute-énergie.
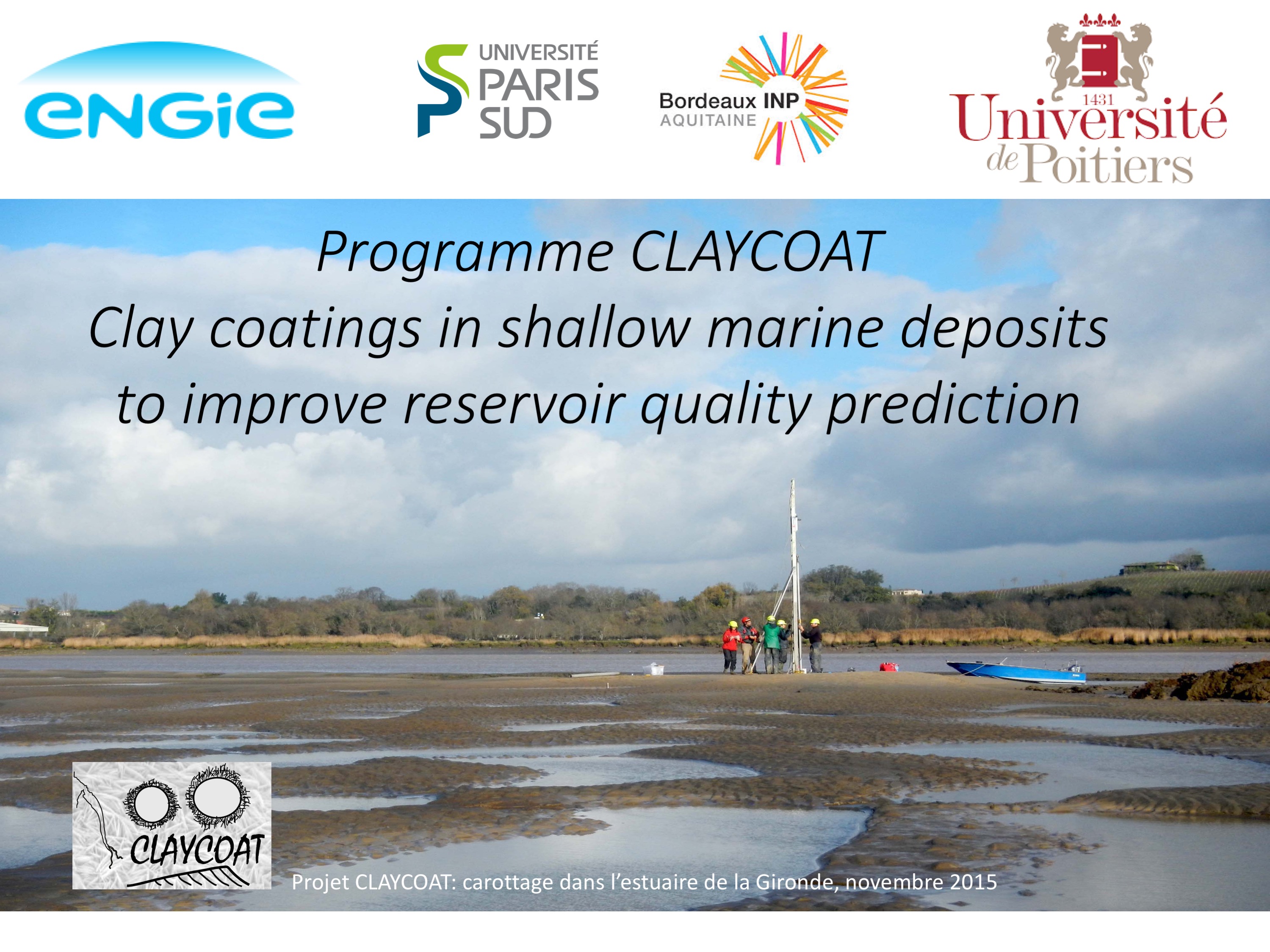





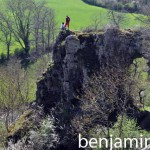



























 orcid.org/0000-0001-6961-2177
orcid.org/0000-0001-6961-2177