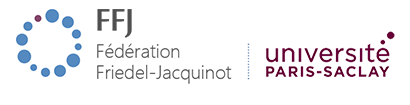On voit de nombreux points communs, parfois même une sorte de parallélisme, entre ces 2 carrières avec environ 10 années d’écart : tous deux formés en province et rejoignant Orsay pour leurs recherches, tous deux fondateurs de laboratoires de la fédération, tous 2 présidents de l’Académie des Sciences, tous deux professeurs de l’Université Paris-Sud. On peut voir des similitudes jusque dans leurs distinctions : prix Holweck, Légion d’Honneur, médaille d’or du CNRS. Tous deux ont eu un rôle national important au niveau de la structuration et de l’organisation de la recherche et de la formation : nous sommes les héritiers du travail qu’ils ont mené pour le rapprochement recherche – formation. Scientifiquement, l’association de ces 2 noms est à même de représenter la variété thématique de la fédération, l’imbrication des recherches de natures expérimentale et théorique, fondamentale et appliquée.
• Pierre Jacquinot est un spécialiste de spectroscopie atomique et instrumentale. Sa thèse portait sur le phénomène Zeeman dans les champs magnétiques intenses. Il a développé la spectroscopie interférentielle : avec Pierre et Janine Connes, il conçoit et réalise le spectromètre à transformation de Fourier, destiné initialement à sonder les atomes. On connaît le retentissement de cette technique expérimentale dans de très nombreux domaines de la physique : les molécules, les solides, et même le domaine spatial puisqu’elle permet aux satellites qui en sont équipés de caractériser les atomes, molécules et ions du milieu interstellaire ainsi que ceux de l’environnement atmosphérique. Ensuite, Pierre Jacquinot consacre ses travaux de recherche à la spectroscopie laser à très haute résolution, qui a notamment permis de mettre en évidence au CERN la raie de résonance de l’atome de Francium.
• Jacques Friedel est le père fondateur de l’école française de physique des solides (on trouve également dans les articles qui lui sont consacrés les termes de « sciences des matériaux », « physique de la matière condensée »). Ses travaux de recherche concernent l’étude théorique des défauts (défauts ponctuels, dislocations) et de la structure électronique des solides métalliques ou covalents. Jacques Friedel a directement travaillé sur des sujets tels que l’ordre et le désordre, l’effet d’impuretés chargées ou magnétiques dans des systèmes extrêmement variés : métalliques, supraconducteurs ou isolants, durs u mous, macroscopiques ou nanoscopiques. Ces études requièrent des collaborations étroites entre différentes disciplines et la mise en jeu de plusieurs domaines d’expertises : aspects structuraux et électroniques de la physique et de la chimie du solide, grands instruments (synchrotrons, réacteurs à neutrons, champs magnétiques intenses) que J. Friedel a toujours soutenus, relations avec les industries de la métallurgie et de l’électronique avec lesquelles J. Friedel a toujours entretenu un dialogue exigeant.
Dans les années 1960, la physique atomique et la matière condensée ne se parlaient pas ou peu mais on constate aujourd’hui, et particulièrement dans le périmètre de nos laboratoires, que le spectre de connaissances et de travaux de recherche entre ces 2 disciplines est devenu un continuum. Ces 2 noms accolés seront donc un trait d’union : de la physique atomique et moléculaire à la matière condensée, en passant par les nanosciences et les systèmes complexes, en allant vers d’autres disciplines telles que chimie et biologie.
• Classes préparatoires scientifiques à Bordeaux puis Lyon
• École polytechnique de 1944 à 1946
•Elève ingénieur des mines à l’École nationale supérieure des mines de Paris de 1946 à 1948
• De 1949 à 1952, thèse de doctorat à l’université de Bristol dans le laboratoire de Nevill Francis Mott.
• Thèse de doctorat ès sciences physiques obtenue à l’université de Paris en 1954.
• 1956 MCF, à la faculté des sciences de l’université de Paris, enseigne en certificat PCB (1re année de médecine) et en 3e cycle de physique des solides à l’Institut Henri-Poincaré
• 1959 : professeur de Physique des Solides de la faculté des sciences d’Orsay, fondation du LPS
• 1980 : création et président (jusqu’en 1996) de l’Association Bernard-Gregory pour l’aide à l’emploi des jeunes docteurs
• Président de l’Observatoire national de la lecture lors de sa création en 1996.
Prix et distinctions :
• Prix Holweck en 1964, médaille d’or d’Acta Metallurgica, prix Heinemann, grande médaille de la Société Française de métallurgie et de matériaux, Von Hippel Award de la MRS, prix Italgas en sciences des matériaux
• Médaille d’Or du CNRS en 1970
• Elu membre titulaire de l’Académie des Sciences en 1977
• Président de l’Académie des Sciences en 1993-1994
• Membre fondateur de l’Académie des technologies en 2000.
• Grand-Croix de la Légion d’Honneur en 2013
• Etudiant à la faculté des Sciences de Nancy jusqu’en 1932 (1er au concours de l’agrégation de sciences physiques)
• Doctorat ès Sciences Physiques en 1937, au Laboratoire du grand électro-aimant à Bellevue
• Chargé puis maître de recherches de la Caisse Nationale de la Recherche Scientifique jusqu’en 1941.
• 1942-1946 : MCF puis professeur à ClermontFerrand
• 1946 : retour à Paris, MCF pour le PCB (1ère année de médecine) puis professeur, recherches au laboratoire du Grand électro-aimant de Bellevue
• 1951 : fondation et direction du Laboratoire Aimé Cotton
• De 1962 à 1969, il est directeur général du CNRS, il invente le concept de laboratoire associé.
• A partir de 1969, président de l’Institut d’optique théorique et appliquée (SupOptique) et professeur à l’université Paris-XI.
Prix et distinctions
• Prix Holweck en 1950
• Prix Jaffé de l’Institut de France en 1962
• Election à l’Académie des Sciences en 1966
• Elu membre titulaire de l’Académie des Sciences en 1966
• Médaille d’Or du CNRS en 1978
• 1979 : Commandeur dans l’ordre de la Légion d’honneur
• Président de l’Académie des sciences de 1980 à 1982
• 1992 : Grand Croix de l’ordre national du Mérite