Gigoux, M., Négrel, P., Guerrot, C., Brigaud, B., Delpech, G., Pagel, M., Augé, T., 2015. δ44Ca of Stratabound Fluorite Deposits in Burgundy (France): Tracing Fluid Origin and/or Fractionation Processes. Procedia Earth and Planetary Science 13, 129-133 Téléchargement
Auteur/autrice : admin (Page 7 of 11)
Le sous-sol français renferme l’une des plus importantes réserves de fluor du monde. En effet, la fluorine est l’un des seuls minéraux contenant assez de fluor pour être exploité : près de 5,5 Millions de tonnes de ce minéral sont présents dans des gisements localisés en Bourgogne, ce qui place la France au sixième rang mondial des pays ayant des réserves connues. Le fluor est un élément hautement important pour l’économie française car beaucoup d’industries en dépendent. Le fluor est indispensable à la fabrication de nombreux composants permettant à la France d’être en bonne position dans le domaine de l’énergie ou de l’automobile. C’est un élément de base utilisé pour séparer les isotopes de l’U dans la fabrication des combustibles nucléaires, ou pour la fabrication de l’acide fluorhydrique (HF) qui permet d’éliminer tous les oxydes inorganiques dans l’industrie du verre, des aciers inoxydables (automobile, éolienne, hydrolienne…) ou du silicium des semi-conducteurs (électronique, photovoltaïque, voiture électrique), ou encore dans son utilisation comme catalyseur des réactions du butène dans le raffinage du pétrole. Son utilisation s’invite même dans notre vie quotidienne en composant nos dentifrices, les mousses synthétiques de nos matelas, les gaz réfrigérants de nos réfrigérateurs ou nos casseroles au téflon. A ce titre, le fluor est classé par l’Union Européenne comme un élément critique du fait de son importance économique et de notre quasi totale dépendance des importations venant de Chine.
De plus, d’un point de vue académique, de grandes incertitudes subsistent sur l’origine du dépôt de fluorine dans les couches sédimentaires. Une origine pratiquement syn-sédimentaire (fini-trias à début jurassique) pour beaucoup de gisements est suggérée, mais est-ce vraiment le cas? Combien y a-t-il de générations? Dans quel contexte géologique se met en place la fluorine bourguignonne? Toute ces questions m’ont poussé il y a un peu plus de quatre ans maintenant à démarrer un programme de recherche en collaboration avec le Brgm. Ce programme me tenait à coeur car étant originaire du Morvan (Rouvray –> à 7 km du gisement de Coucelles-Frémoy…), je me suis depuis longtemps posé la question de leur formation. Ce projet s’intègre parfaitement dans les thématiques de ma recherche dont une partie vise à comprendre l’évolution physico-chimiques des sédiments remplissant les bassins. Allier une question scientifique (compréhension de la diagenèse) sur une région que je connais par coeur a donc clairement initié ce projet. La volonté du laboratoire GEOPS à étudier les ressources (la volonté de Maurice Pagel à aller dans ce sens a été déterminante) et le soutien financier du brgm a permis de mener à bien ce projet avec le recrutement de Morgane Gigoux qui a effectuée sa thèse de doctorat sur cette thématique. Les réserves françaises de fluorine ont pu être examinées de très près en essayant d’en caractériser leur origine. L’objectif final est simple : mieux comprendre leur formation permettra de mieux orienter les futures prospections. Les gisements observés de l’échelle de l’affleurement jusqu’à l’échelle microscopique par différentes méthodes les ont conduit à déterminer très précisément l’âge de formation de ces gisements afin de pouvoir les intégrer dans une histoire géodynamique globale. C’est avec plaisir que une partie des travaux vient d’être publiée dans la revue Mineralium Deposita, ce qui démontre l’intérêt géologique du site étudié (Pierre-Perthuis).
Afin de reconstruire une origine de mise en place dans un cadre géodynamique bien contraint, l’information la plus importante à obtenir est l’âge de la minéralisation. L’étude a porté sur un des gisements bourguignons, celui de Pierre-Perthuis (1,4 Mt de fluorine). Le niveau minéralisé se localise dans les premiers niveaux sédimentaires ici dolomitiques, remplissant la base du bassin de Paris dans sa partie sud-ouest, et déposés à la fin du Trias (vers 210 Ma). Les échantillons collectés sur le terrain ont été minutieusement observés à l’aide de plusieurs microscopes : photonique, à cathodoluminescence et électronique. Le gisement renferme environ une trentaine de pour cent de fluorine, le reste étant principalement du quartz et de la barytine. Cette phase d’observation a permis d’identifier et individualiser une même génération de cristaux de fluorine bien homogène sur six échantillons. Les fluorines contiennent une infime quantité d’éléments de Terres rares (quelques dizaine de ppm ou 0,001%) dont du Samarium (147Sm ) et Néodyme (143Nd/144Nd). Même en infime quantité, les isotopes du Samarium et Néodyme ont été analysés au spectromètre de masse. Cette méthode géochronologique permet d’obtenir un âge de minéralisation et donc de mise en place du volume de fluorine qui est ici daté du Crétacé inférieur (130 Ma), soit 80 Ma d’années après le dépôt sédimentaire carbonaté. Cette période est marquée par des mouvements géodynamiques importants avec le début de l’ouverture de l’Atlantique centrale, le Rifting du Golfe de Gascogne et des Pyrénées. Ces mouvements se font ressentir jusque dans la moitié nord de la France, où les bordures du bassin de Paris se sont surélevées. Cette surélévation a engendré un gradient hydraulique, qui a pu mettre en mouvement des fluides circulant à la base du bassin. Cette circulation est à l’origine de la mise en place de ces importants gisements en France. Du point de vue de l’exploration, ces minéralisations reconnues sur la bordure affleurante sud-ouest du bassin, pourraient être présentes également dans le même niveau mais à l’intérieur du bassin.
Gigoux, M., Delpech, G., Guerrot, C., Pagel, M., Augé, T., Négrel, P., Brigaud, B., 2015. Evidence for an Early Cretaceous mineralizing event above the basement/sediment unconformity in the intracratonic Paris Basin : paragenetic sequence and Sm-Nd dating of the world-class Pierre-Perthuis stratabound fluorite deposit. Mineralium Deposita. 50 : 455–463
Retrouvez cet article sur le site web de l’Université: http://www.actu.u-psud.fr/fr/recherche/actualites-2015/sur-la-piste-du-fluor-francais.html
Retrouvez le détail du sujet de thèse démarrant à la rentrée 2015. (Lien Web). Ce sujet de thèse intitulé « Origine et prédiction spatio-temporelle des tapissages argileux dans les réservoirs silicoclastiques – Apports de la comparaison entre des réservoirs anciens (Dévonien à Jurassique) et d’analogues actuels (Bassin d’Arcachon et Estuaire de la Gironde) » vise à mettre en parallèle (1) des observations et caractérisations sédimentologiques de dépôts quaternaires avec (2) des observations et analyses d’échantillons de subsurface afin de mieux comprendre l’origine du développement des tapissages argileux dans les grès. Il s’agira également de tester le degré de relation entre ce processus physico-chimique et le développement de réservoirs ou la préservation de qualités réservoirs. Ce projet s’insère dans un programme de recherche et développement (R&D) en géologie sédimentaire intitulé CLAYCOAT « CLAY COATing in shallow marine clastic deposits to improve reservoir quality prediction ». CLAYCOAT est un programme national financé par ENGIE associant les Universités Paris-Sud, de Poitiers, l’Institut Polytechnique de Bordeaux et ENGIE.
- ENGIE
- Poitiers
- Bordeaux
- Paris-Sud
Pour la deuxième année consécutive, une excursion géologique en Bourgogne « Des carbonates récifaux jurassiques au gisement de Fluorine de Pierre-Perthuis » a permis de découvrir cette région d’un point de vu sédimentologique, stratigraphique et métallogénique. La mise en place des sédiments carbonatés a pu être discutée avec les concepts de stratigraphie séquentielle sur le site du Rocher du Saussois. Une initiation à l’élaboration d’une paragenèse minérale a été réalisée directement sur le terrain (fluorine, barytine quartz, malachite, azurite) sur le site de la Roche Percée à Pierre-Perthuis. Organisée dans le cadre d’une sortie pour l’Association des Géologues de l’Université Paris-Sud (AGUPS), la sortie s’est terminée par une descente en canoë de la Cure.
- Rocher du Saussois
- Rocher du Saussois – stratigraphie
- Mise en place des carbonates
- discussion sur les carbonates
- Roche aux poulets
- Roche percée – Pierre-Perthuis
- Roche percée
- descente de la Cure
- Descente de la cure
- photo de groupe 2015
Quelques photos réalisées lors de l’excursion du Groupe Français d’Etude du Jurassique le 9 avril 2015.
lien: http://www.gfej.asso.u-psud.fr/retour-sur-les-journees-du-gfej-2015/
lien: https://pascalneige.wordpress.com/2015-04-excursion-du-gfej/
- Musée de Semur-en-Auxois
- Stratotype du Sinémurien
- Stratotype du Sinémurien
- Carrière de Semur-en-Auxois
- Carrière de Massangis
Les 8 et 22 novembre 2014, deux sorties sédimentologiques dans l’estuaire de la Gironde ont permis de réaliser un échantillonnage de huit bancs de sable accessibles à marée base par bateau . Ces sorties ont été réalisées par Maxime Virolle, Raphaël Bourillot et Hugue Feniès (Université de Bordeaux) et Benjamin Brigaud (Université Paris-Sud). Cet échantillonnage est la première mission de terrain entrant dans le cadre du projet scientifique CLAYCOAT « CLAY COATing in shallow marine clastic deposits to improve reservoir quality prediction » (collaboration entre les Universités de Paris-Sud, Poitiers, de l’Institut Polytechnique de Bordeaux et Gdf-Suez). Ce projet de recherche et développement (R&D) en géologie sédimentaire vient de démarrer et s’entendra jusqu’en 2018. L’objectif de ce projet R&D est d’essayer d’améliorer notre compréhension sur le dépôt d’argile dans les séries sableuses estuariennes, formant de minuscules (10 micromètres) tapissages argileux autour des grains de quartz. Même minuscules, ces tapissages favorisent la conservation des bonnes porosités et perméabilités des sédiments lors de leur enfouissement, même à très grandes profondeurs (>3500m) et contribuent ainsi à former des réservoirs d’eau ou d’hydrocarbures. En revanche, les conditions de formation de ces argiles restent très peu connues (lieu dans l’estuaire, chimie de l’eau, timing…). Par analogie, trouver le lieu exact de formation de ces tapissages dans des estuaires actuels (Gironde et Bassin d’Arcachon) va permettre d’améliorer considérablement la connaissance des estuaires ayant des millions d’années et d’améliorer l’exploration pétrolière et les prédictions de l’architecture des réservoirs gréseux.
L’article intitulé « Acoustic and reservoir properties of microporous carbonate rocks : implication of micrite particle size and morphology » par Jean-Baptiste Reget, Philippe Robion, Christian David, Jérôme Fortin, Benjamin Brigaud et Béatrice Yven est prêt pour une publication dans la revue Journal of Geophysical Research : Solid Earth.
Ce travail correspond à une collaboartion entre l’Université de Cergy-Pontoise et l’Université Paris-Sud sur le projet de recherche « Apport de la connaissance des propriétés acoustiques des roches sur la conceptualisation des niveaux transmissifs de la Zone de transposition Andra « , projet financé par le programme interdisciplinaire du CNRS « PACEN » (Programme sur l’Aval du Cycle et l’Energie Nucléaire).
Les principaux résultats ont permis d’améliorer notre connaissance de l’influence des paramètres microstructuraux sur la propogation des ondes acoustiques (P et S) dans les carbonates micritiques. Il s’avère que la vitesse de ces ondes sont largement influencée par la morphologie des cristaux microscopiques de calcite (micrites) et par la nature de leur contact (degré de coalescence).
Du 13 au 17 octobre 2014 a eu lieu le stage de terrain de Master 2 « Environnements sédimentaires » de l’Université Paris-Sud. Ce stage a permis aux étudiants de décrire environ 400 mètres de coupes dans les séries argilo-carbonatées du Jurassique moyen et supérieur de l’Est de la France. Ces descriptions ont été réalisées dans des carrières dont certaines peuvent présenter une centaine de mètres, en hauteur, de roches, mais également à partir de carottes stockées dans la carothèque de l’Andra à Bure (55). Les étudiants ont ainsi pu s’exercer aux levés sédimentologiques sur carottes et constater les différences d’aspect entre les mêmes roches à l’affleurement et en carottes (jusqu’à 700 m de profondeur).
A partir de ces données sédimentologiques, les descriptions de faciès (clasts, liant, structure sédimentaires, bioturbations, perforations…) ont permis aux étudiants de discuter et proposer (1) une séquence stratigraphique synthétique, (2) un log synthétique, (3) un schéma de corrélation stratigraphique et (4) une interprétation du dépôt des différents cortèges stratigraphiques de la région.
Du 11 au 26 juillet, une mission de terrain a été organisée sur les carbonates du Jurassique des Charentes (d’Angoulême à La Rochelle) et du Nord de la Dordogne (Nontron) par Simon Andrieu. Une trentaine de coupes dans des carrières et le long de la côte charentaise ont été levées afin de bien caractériser les faciès sédimentaires. Cette mission forme la dernière partie d’étude de terrain, après la Normandie, la Sarthe et le Poitou, de la thèse de Simon Andrieu, qui vise à étudier l’évolution de la plateforme jurassique sur la partie ouest de la France du Bassin de Paris au Bassin Aquitain.
Communications à venir :
Simon Andrieu, Benjamin Brigaud, Jocelyn Barbarand, Eric Lasseur. 2014. Facteurs contrôlant l’évolution des paléoenvironnements et de l’architecture des carbonates du Jurassique moyen et supérieur de l’ouest du bassin de Paris.
lors de la 24e Réunion des Sciences de la Terre, Pau, 31 octobre 2014
et lors du colloque « Géologie du Bassin parisien, Le Cinquantenaire de l’AGBP », Paris, 12-13 novembre 2014
L’article intitulé « Characterization and origin of permeability-porosity heterogeneity in shallow-marine carbonates : from core scale to 3D reservoir dimension (Middle Jurassic, Paris Basin, France) » par Benjamin Brigaud, Benoît Vincent, Christophe Durlet, Jean-François Deconinck, Emmanuel Jobard, Niel Pickard, Béatrice Yven et Philippe Landrein est prêt pour une publication dans la revue Marine and Petroleum Geology.
Un des défis dans le domaine des sciences de la terre est d’arriver à mieux appréhender le changement d’échelle entre la caractéristique d’un échantillon de roche observée en laboratoire, parfois jusqu’à l’échelle micrométrique et son comportement in situ, dans le sous-sol à l’échelle plurikilométrique. Ce changement d’échelle peut s’avérer particulièrement important pour comprendre, prédire et ainsi visualiser en 3D certaines ressources présentes dans le sous-sol comme l’eau, les hydrocarbures ou les métaux. Les roches sédimentaires du sous-sol, notamment carbonatées, peuvent former des réservoirs pour les ressources en eau ou en hydrocarbures, dont une forte porosité et perméabilité est un gage de qualité. Ces aquifères ou réservoirs d’hydrocarbures sont étudiés à partir de forages, donnant un aperçu très ponctuel de la qualité, par exemple 2 km de long avec un diamètre ne dépassant pas 20 cm, de l’ensemble de la roche contenant cette ressource, dont le volume total peut atteindre plusieurs milliers de kilomètres cube.
Une collaboration entre universitaires (Université Paris-Sud et Université de Bourgogne) et industriels (Cambridge Carbonate, Andra, Statoil, Captair) dirigée par Benjamin Brigaud (Géosciences Paris Sud, Université Paris-Sud/CNRS) a apporté une méthode innovante sur ce changement d’échelle en étudiant un ensemble de roches carbonatées épais de 200 m et enfouis à plus de 500 m de profondeur dans l’Est du Bassin de Paris. Cette nouvelle méthode se déroule en cinq étapes. (1) La première consiste à reconstruire précisément, par une étude des faciès sédimentaires, la géométrie de l’ensemble formant un empilement d’une dizaine de couches. (2) La deuxième étape consiste à l’analyse en laboratoire de la perméabilité (de 0,01 mDarcy à 1 Darcy), de la porosité (de 1 à 17%), du rayon de l’espace connectant deux pores entre eux (variant de 0,25 µm à 32 µm) et surtout du signal en résonance magnétique nucléaire (RMN) des roches carbonatées du site prélevées dans un forage, rendant compte de leur hétérogénéité. Sur ces mêmes échantillons, l’espace poreux a été observé à très petite échelle au MEB afin de préciser la forme des pores ou leur variation de taille (de 1 µm à 100 µm). Ces analyses de laboratoire ont permis de redéfinir les équations permettant de calculer à partir du signal RMN, la porosité ou la perméabilité des roches carbonatées. (4) Dans une quatrième étape, le signal RMN a été mesuré dans 12 puits à partir d’une sonde. Les nouvelles équations utilisées ont permis d’avoir un enregistrement continu de la porosité sur presque 2 km. (5) Un logiciel de modélisation géologique performant a été utilisé afin de propager les caractéristiques de perméabilités et porosités mesurées à partir du signal RMN entre les 12 forages dans 109 millions de cellules mesurant 150 m de longueur, 150 m de large et 5 m de hauteur. Les investigations dans les forages permettent de connaître un volume d’environ 20 m3. Ce volume réellement investigué représente 1/1000 d’une cellule du modèle, à comparer aux 109 millions qu’il faut contraindre…
Cette calibration très fine des calculs de perméabilités à partir des signaux RMN mesurés en laboratoire et la mesure de la RMN sur 12 puits en diagraphie permettent d’observer la distribution hétérogène de la porosité et de la perméabilité depuis l’échelle ponctuelle dans les forages à celle d’un réservoir de 400 km3 modélisé en 3D.











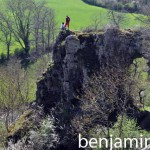











 orcid.org/0000-0001-6961-2177
orcid.org/0000-0001-6961-2177